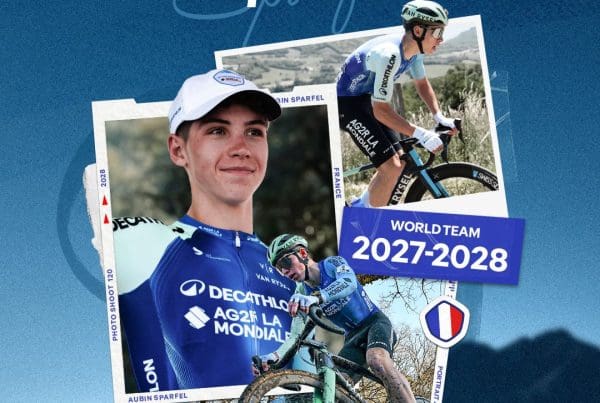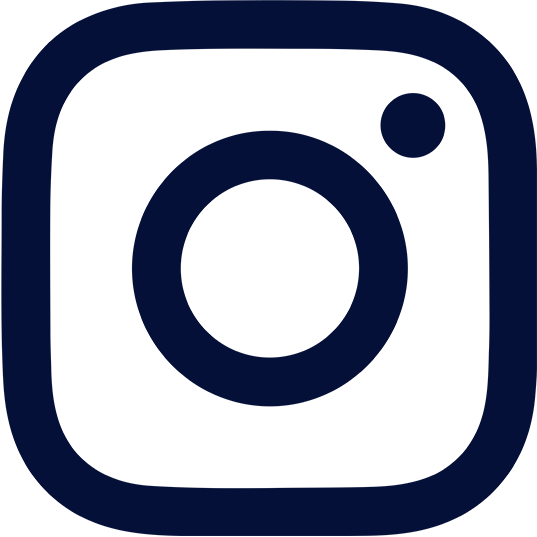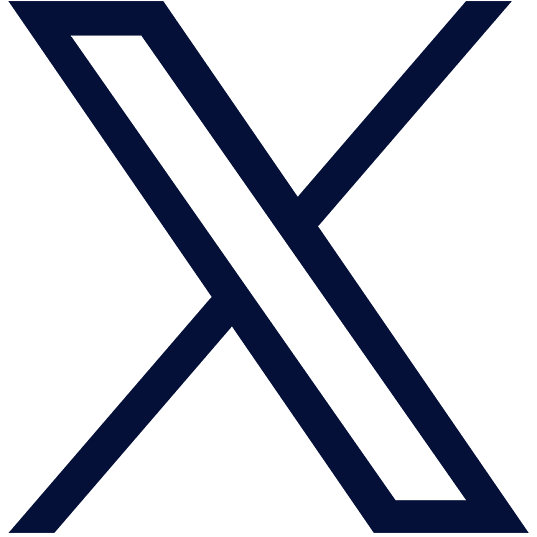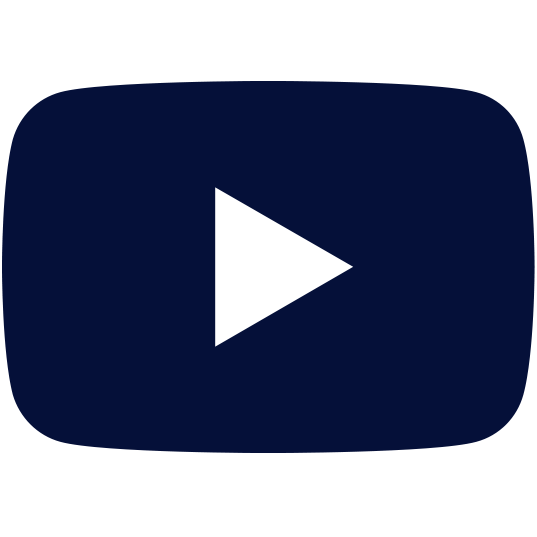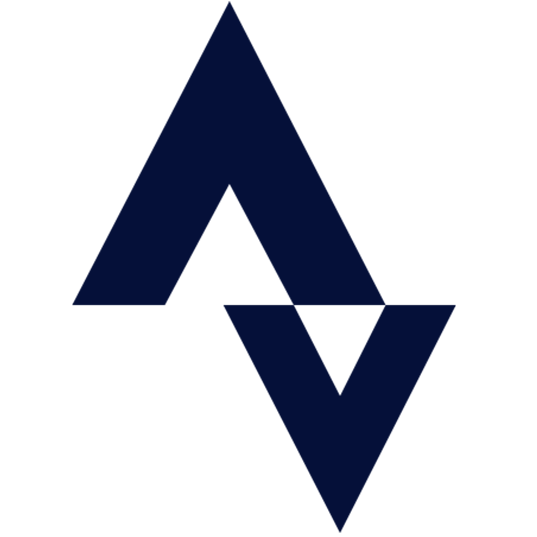“Il y a eu une forme de révolution en 2010 quand des équipes cyclistes ont commencé à regarder ce qu’il se faisait en athlétisme ou en natation.”
Jean-Baptiste Quiclet, directeur de la performance de DECATHLON AG2R LA MONDIALE
Cette phrase nous a interpellé autant qu’elle a suscité notre curiosité lorsque nous nous sommes entretenus avec Jean-Baptiste à propos des grandes évolutions contemporaines du cyclisme professionnel. Notre sport a toujours évolué, rapidement. C’est dans son ADN. Mais jamais avant les quinze dernières années, les évolutions n’avaient été si nombreuses et radicales.
Diminution du volume de compétition, séquençage des saisons par objectifs, groupes de coureurs, multiplication des stages… Dans les coulisses de la cellule performance, Jean-Baptiste a décrypté pour nous la façon dont les saisons de nos coureurs se pensent et s’écrivent. Une partition complexe qui doit mettre en harmonie une multitude d’acteurs (entraîneurs, coureurs, directeur sportifs, experts techniques) et trois grandes phases : préparation, compétition, repos.
Pour la dizaine d’entraîneurs et d’experts qui sont les artisans de cette performance, la planification est devenue un cheval de bataille.
1. Préambule : des saisons métamorphosées
Si les saisons cyclistes sont parmi les plus longues du sport professionnel (environ 10 mois de compétition étalés de janvier à octobre), le nombre de jours passés en compétition par les coureurs cycliste est en baisse depuis deux décennies.
Dans les années 2000, un coureur cycliste professionnel accrochait en moyenne 95 dossards par saison alors que les coureurs les plus engagés pouvaient cumuler jusqu’à 110 jours de compétition par an. En 2008, le vainqueur du Tour de France terminait la saison avec plus de 80 jours de course.
Vingt ans plus tard, les cyclistes courent 20% de moins qu’avant. 75 jours en moyenne pour 92 jours au maximum (Patrick Gamper en 2024). Les prétendants au classement général des grands tours font encore plus baisser le volume : Jonas Vingegaard n’a pas fait plus de 60 jours de course en 2023, année de son second sacre sur le Tour de France.
Au cœur de cette évolution, un changement d’approche de l’entraînement et plus globalement de la performance : courir moins mais mieux.
Un nouveau paradigme qui a bouleversé la planification des saisons et qui a fait la part belle à l’entraînement qui s’est intensifié et optimisé. Au cœur de ces changements, la multiplication des stages notamment.

2. S’entrainer plus et mieux
Aujourd’hui, un coureur cycliste passe environ autant de jours en compétition qu’en stage à l’échelle d’une saison (une soixantaine de jour pour chacun de ces deux blocs).
Autrefois, les saisons cyclistes se résumaient à une phase de préparation hivernale de quelques mois d’endurance puis une très longue saison de compétitions et de (courts) temps de repos. Considérant que la compétition était le meilleur des entraînements, les cyclistes enchaînaient les courses jusqu’à atteindre leur pic de forme.
C’est à partir de 2010 que le cyclisme a pris un virage en s’inspirant notamment d’autres sports d’endurance tels que la natation ou l’athlétisme. Dans ces disciplines où le volume de compétition est moins important que dans le cyclisme, les saisons se dessinent autour d’objectifs ciblés et éloignés, rendant les phases d’entraînement distinctes mais primordiales pour être sûr d’arriver compétitif le jour-j.
C’est ce désir d’optimisation de la performance et des résultats qui fut le premier moteur de ces changements : mieux encadrer les pics de forme pour ne pas manquer les grands rendez-vous.
En outre, d’autres facteurs plus marginaux ont aussi poussé les professionnels de la performance à revoir la place de l’entraînement par rapport aux courses et à le privilégier dans l’organisation des saisons. Selon Jean-Baptiste Quiclet l’entraînement permet de :
- Réduire la fatigue mentale et physique généré par les compétitions (déplacements, stress, risque de maladie).
- Mieux piloter l’effort et la charge de travail : face à l’impossibilité de présager des scénarios de courses, la compétition s’est avérée ne pas être le meilleur endroit pour piloter l’intensité de l’effort. Le progrès technologie a lui permis de rendre les entraînement hyper précis et même « plus durs que les courses » selon Jean-Baptiste Quiclet, directeur de la performance de notre équipe.
- Lever des contraintes liées à réalisation de certaines méthodes de préparation comme l’entraînement en altitude.
3. La structuration de la performance
Cette mutation dans la façon de pratiquer le sport cycliste fut un défi pour les structures professionnelles. Avec des équipes ultra-innovantes en tête, chacune a rapidement su qu’elle devait mettre en place les conditions de l’innovation.
Dans notre équipe, le but fut d’apporter un œil neuf dans la préparation et de l’individualiser. Jean-Baptiste Quiclet fut un pionnier dans cette approche visant à décorréler la planification des saisons du simple calendrier mondiale des courses.
Afin de repenser avec ambition cette planification et de se donner les moyens de l’expérimentation, la cellule performance de l’équipe DECATHLON AG2R LA MONDIALE s’est structurée.
Elle est aujourd’hui pilotée par son directeur, Jean-Baptiste Quiclet. Il supervise la performance sous ses différents volets :
- L’innovation technique : matériel, aéro, nutrition, position. Il est accompagné d’experts techniques multidisciplinaires, artisans de l’innovation et génie de sa mise en place.
- La planification de l’entraînement. Accompagné de Stephen Barret, Head Coach, qui supervise lui une équipe d’une dizaine d’entraîneurs, tous spécialisés.

Une équipe complète et motivée par un même objectif : permettre à la direction sportive d’aligner les fronts les plus compétitifs sur chaque course.
Dans leur travail de planification, les entraîneurs de l’équipe bâtissent différents plans stratégiques à plusieurs échelles :
- Des groupes de courses et des objectifs sportifs pour chaque groupe (Classiques, courses à étapes, Grands Tours).
- Des groupes de coureurs en face des objectifs sportifs
- Des blocs de préparation pour chaque groupe et articulés autour des grands objectifs
Tout ce travail conduit les entraîneurs à produire pour chaque coureur de l’effectif :
- Un calendrier de courses
- Un plan d’entraînement quotidien
- Un calendrier de stages
4. Les types de stages et leurs objectifs
Dans cette approche, la place des stages fut déterminante. Aussi bien que les stage furent l’objet de bien des discussions sur la planète cyclisme. Un temps questionné, on considérait qu’un coureur cycliste pouvait tout à fait s’entraîner sérieusement à la maison.
Or, au-delà des spécificités propres à quelque stages (comme ceux de début de saison ou en altitude notamment), les structures professionnelles les ont multipliés dans ce même souci d’optimisation de l’entraînement, colonne vertébrale de toutes ces transformations.
Si les objectifs techniques des stages peuvent varier, ils sont tous pensés pour offrir aux coureurs un environnement de travail et de récupération optimal. Ils offrent au coureur l’accès à un staff dédié sur place pour encadrer l’entraînement et l’intendance nécessaire pour les soins et la gestion du matériel (cuisinier et nutritionniste, kinés, ostéopathe, mécaniciens, assistants).
Les stages sont aussi des occasions de réunir les coureurs d’un même groupe de courses et de les faire travailler ensemble, ils sont la clé d’une solide cohésion de groupe et assurent une motivation supplémentaire pour pousser chaque coureur à dépasser ses limites à l’entraînement.
Hormis les stages de début de saison qui sont effectués en effectifs complets, chaque stage est effectué à une dizaine de coureurs maximum afin de permettre une quasi-individualisation du suivi de l’entraînement durant ces périodes clés.
Ces stages sont organisés, préparés et placés des entraineurs en fonction de leur spécialité : c’est l’entraîneur des sprinteurs qui organisent les stages sprints et l’entraîneur des grimpeurs qui dirige les stages en altitude.
L’ensemble des stages sont organisés autour d’une thématique précise. Elle constitue généralement un axe de travail global en vue d’un bloc de course mais elle peut-aussi être liée à une course spécifique, comme les stages de reconnaissance.
Si la typologie des stages ou leur récurrence peut évoluer en fonction des objectifs et des effectifs, on retrouve une liste de stages « piliers » au fil des saisons dont voici quelques exemples :

- Les stages de début de saison du mois de décembre et de janvier. Ils sont effectués en effectifs complets et servent à lancer la saison. Ils sont un temps précieux de cohésion d’équipe et de travail foncier sur le vélo et à côté, notamment grâce de nombreuses séances de renforcement musculaire. Ils sont aussi le moment d’échanges entres les coureurs et toutes les composantes du staff pour dessiner la saison de chaque coureur. Enfin, c’est le moment de mise en place du nouveau matériel et des éventuelles obligations liées à la communication.
- Un premier stage en altitude intervient peu de temps après les premières courses, au mois de février. Ils s’adressent aux coureurs qui préparent le Tour de France essentiellement. La particularité des stages en altitude est qu’ils sont particulièrement longs. En effet, la période d’acclimatation dure plusieurs jours et les bénéfices du travail en altitude sont effectifs à partir de plusieurs semaines seulement. C’est donc dans une véritable bulle de travail de plusieurs semaines que se mettent les coureurs qui partent en stage en altitude. Ils y sont en effectifs très réduits (coureurs et staff compris) et cela a aussi des vertus de cohésion de groupe. En hiver, ces stages se déroulent principalement en Sierra-Nevada en Espagne, sur l’île de Tenerife ou à l’Etna en Italie.
- A l’approche des classiques, des stages de reconnaissances peuvent être organisés. Ils servent à effectuer des séances intenses « en condition » sur les pavés des parcours flandriens. Ils ont également vocation à effectuer des tests matériels primordiaux pour bien aborder ces échéances hautement tactiques.
- En fonction des objectifs et des coureurs sélectionnés, un stage de préparation au Giro a lieu en avril. Cette année, ce sera un stage de préparations avec une dominante « sprint » autour de Sam Bennett et du collectif qui l’accompagnera sur le Tour d’Italie.
- En mai ou juin, un second stage en altitude a lieu en vue du Tour de France. C’est l’ultime bloc de travail intensif avant les courses de préparation au Tour de France (Critérium du Dauphiné ou Tour de Suisse). Les possibilités de destination sont plus nombreuses durant l’été puisque les coureurs peuvent se rendre dans les hautes stations alpines (Les Arcs, Tignes, Val d’Isère) ou à Font-Romeu qui se situent à des altitudes suffisantes pour bénéficier des bienfaits de l’altitude.
- En fonction du calendrier, des mini stage de reconnaissance ont lieu en début d’été pour reconnaître les étapes les plus importantes (ou les plus techniques) du Tour de France.
- En juillet, les coureurs qui ne participent pas au Tour de France effectuent un « stage montagne » afin de travailler des dénivelés importants à l’entraînement. Cette année, ce stage sera divisé en deux groupes pour favoriser l’individualisation : un groupe Vuelta et un groupe de coureurs engagés sur les autres objectifs de la deuxième partie de saison.
- A divers moments de la saison d’autres stages « techniques » peuvent être organisés pour effectuer un travail de fond sur le matériel ou la position : journées en soufflerie.
Voilà donc pourquoi et comment ces stages sont devenus des piliers (entre autres) de la saison de nos coureurs et de leur quête de performance.
Des saisons définitivement articulées autour de feuilles de routes complexes et dont l’objectif compte désormais tout autant que la route pour l’atteindre.
S’il est vrai que la place de l’entraînement a considérablement évoluée, elle a aussi permis au cyclisme d’être encore plus compétitif. Les cyclistes courent moins mais ils courent mieux.
Chaque course est un spectacle qui se joue par des acteurs finement préparés et super déterminés, notamment car leur calendrier s’allège. Un appel au panache, pour notre plus grand bonheur.